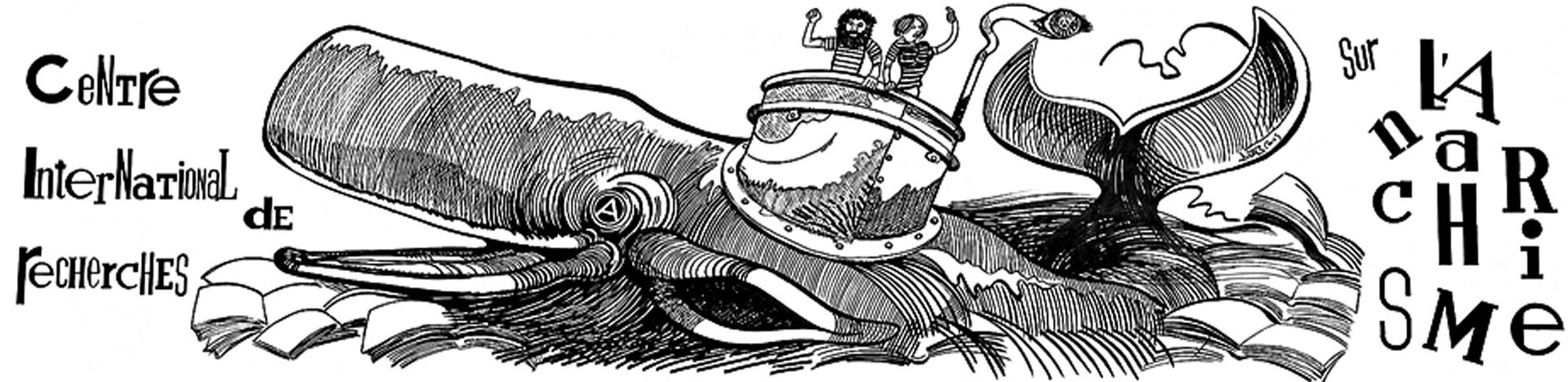L’anarchisme en Colombie
La Colombie, tout comme le Venezuela, n’a pas eu de mouvement anarcho-syndicaliste comparable par sa puissance et son importance à celui d’autres pays sud-américains (Uruguay, Argentine, Brésil, etc.). Il fut pourtant plus important que chez son voisin et il fut à l’origine de luttes mémorables et héroïques dans les années 1920. Il produisit, par ailleurs, quelques figures remarquables et dignes d’être reconnues dans les domaines de l’idéologie, de la propagande et de la littérature.
Il est intéressant et curieux de noter que la Colombie fut le seul pays d’Amérique latine à recevoir la visite de deux grands penseurs anarchistes du XIXe siècle : Élisée Reclus et Michel Bakounine. L’Argentine accueillit plus tard Errico Malatesta, Pietro Gori et d’autres figures marquantes de l’anarchisme européen.
Bakounine, pourtant, ne resta que quelques jours en 1861 dans l’isthme de Panamá, qui faisait alors partie de la République de Colombie : après s’être échappé de la Sibérie orientale vers le Japon, il arriva à San Francisco aux États-Unis, et de là il s’embarqua pour Panamá, traversa l’isthme et s’embarqua de nouveau à Aspinwall-Colón vers New York, pour continuer ensuite son voyage vers Londres. Il ne semble avoir participé à aucun travail de propagande ou d’organisation ni en Colombie (Panamá) ni aux États-Unis (San Francisco-New York)[1].
Élisée Reclus visita la Colombie en tant que géographe et il entreprit une expédition scientifique en 1855 comme le faisaient les savants européens du XIXe siècle). Ce voyage est à l’origine de son ouvrage Voyage à la Sierra Nevada de Sainte-Marthe, publié à Paris en 1861[2].
En Colombie, comme dans les autres pays d’Amérique latine (avec la seule exception peut-être du Mexique), quand il s’agit d’écrire l’histoire de l’origine et de l’organisation du mouvement ouvrier, ainsi que de ses luttes, on a l’habitude de prendre seulement en compte l’activité des partis politiques (communistes, socialistes, libéraux). Libéraux et marxistes « se disputent entre eux le rôle principal dans cette période de l’histoire colombienne et se proclament les promoteurs du développement de la classe ouvrière ». En conséquence, « le parti communiste et le parti libéral se sont chargés peu à peu d’effacer la participation des secteurs qui ne faisaient pas partie de leurs projets »[3].
En Colombie, comme dans les autres pays d’Amérique latine, on peut dire que les véritables initiateurs des luttes et de l’organisation ouvrière furent les anarchistes.
Vers la moitié du XIXe siècle, dans ce pays, comme dans presque tous les autres d’Amérique latine, divers acteurs du socialisme utopique se mirent en relation avec « les luttes artisanales contre les effetsdestructeurs du libre-échange »[4]. Entre 1847 et 1854, quelques cercles intellectuels lisaient et commentaient non seulement les œuvres de Fourier et de Saint-Simon mais aussi celle du proto-anarchiste P.-J. Proudhon. Il en est de même au Venezuela où Fermín Toro montre les influences des socialistes utopiques et Baralt cite fréquemment les écrits de Proudhon qu’il avait personnellement connu à Paris. Même Simón Rodríguez, professeur de Bolívar, accueillit avec enthousiasme certaines idées de Fourier, et pour cela, non sans raison, Manuel Díaz Rodríguez dit de lui qu’il fut incompris par ses contemporains « parce qu’il devançait dans l’Amérique de son temps l’Europe socialiste d’aujourd’hui »[5].
Il vaut peut-être la peine de rappeler que Pierre Cerreau, exilé au Venezuela après l’échec en France de la révolution démocratique-socialiste de 1848, publia dans la ville de La Victoria le journal Credo igualitario, inspiré à l’origine par les idées communistes de Babeuf et des « Égaux ».
Ezequiel Zamora lui-même, protagoniste de la Guerre fédérale et « général du peuple souverain », aspire à rivaliser avec la « philosophie de l’égalité de Babeuf »[6]. À partir de 1851, il s’intéresse aux idées des autres socialistes pré-marxistes, il dialogue dès 1849 avec Luciano Requena et José Branford à propos de la république sociale » et d’Auguste Blanqui[7]. Ensuite il découvre et admire, grâce à l’universitaire Francisco J. Iriarte, les idées de Proudhon, dont il commente la théorie de la propriété : « Zamora considère que dans les Llanos la terre n’est à personne ; elle est à tous par usage et par coutume, et que de plus, avant l’arrivée des Espagnols, les ancêtres des godos [conservateurs] d’aujourd’hui, la terre était bien communcomme l’eau, l’air et le soleil. José Branford lui répond que, certes, quelqu’un vola une chose qui n’était pas à lui mais qui appartenait à tous et que Proudhon, de cette manière, avait raison quand il considère que la propriété est un vol »[8].
En Colombie les idées de Proudhon sont diffusées, entre autres par le journal El Neogranadino, de Manuel Murillo Toro. Les nombreuses allusions aux idées de l’anarchiste français dans les polémiques idéologiques des années 1850 nous permettent d’en déduire que ces idées influencèrent les membres des Sociétés démocratiques (1847-1851). L’organisation de ces associations laisse entrevoir certains éléments de l’idéologie de Proudhon, bien qu’elle soit sans doute mêlée avec les idées courantes du Parti libéral de cette époque[9]. Miguel Urrutia Montoya rapporte que dans les débats de ces associations il était fréquent d’avoir recours à la célèbre sentence proudhonienne : « La propriété c’est le vol »[10].
On peut dire, sans aucun doute, que quelque chose de semblable apparaît à la même époque dans d’autres pays latino-américains. Au Mexique, par exemple, Melchor Ocampo, secrétaire de Benito Juárez[11], traduisit une partie de La philosophie de la misère de Proudhon, sans être un véritable proudhonien[12]. Un peu plus tard, la figure singulière de Plotino C. Rhodakanaty, philosophe panthéiste grec et médecin homéopathe, introduisit au Mexique les idées de Fourier et de Proudhon[13].
Pendant l’Empire et la Réforme, de telles idées ne cessèrent de se diffuser et furent portées sur le terrain de la lutte ouvrière-artisanale et paysanne[14].
Alfredo Gómez rappelle qu’en 1853 étaient publiés au Chili des brochures telles que Anarquía y rojismo en Nueva Granada de M. Ancízar et des observations sur les idées anarchistes dans la République de Colombie par un auteur anonyme[15].
En Colombie, « après le coup d’État réalisé par José Mará Melo, avec l’appui de nombreux secteurs populaires, dont les artisans, on connut un programme de gouvernement inspiré en grande partie par les Sociétés démocratiques qui peut donner à penser que Proudhon apporta son grain de sable à travers ses idées. Cela se ressent dans le refus de la représentation politique, le respect de l’autonomie populaire pour se gouverner soi-même, la non-reconnaissance des lois et de la constitution existantes, la lutte contre les monopoles et dans l’accent mis sur les vertus libératrices du travail et de l’éducation. Mais la déduction ne peut être une conclusion indiscutable car d’autres points du programme sont en contradiction avec l’esprit de nombreuses idées de Proudhon ; par exemple, le gouvernement était plus centralisateur que les précédents et quelques hiérarchies ecclésiastiques furent rétablies »[16].
Il y a sans doute dans tout cela non seulement de l’éclectisme mais aussi peu de clarté dans les idées. On ne peut non plus nier une influence proudhonienne dans la Constitution fédéraliste de Río Negro. L’aile gauche du libéralisme voisinait parfois avec l’anarchisme (et les romans de García Márquez le font parfois remarquer), comme l’aile droite du conservatisme s’identifiait avec les idéologies européennes préfascistes (et ensuite, phalangistes et fascistes). Il suffit de lire les écrits de Laureano Gómez, exaltés au Venezuela par le jeune Herrera Campins.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la Colombie ne reçut qu’une faible immigration européenne, à la différence de l’Uruguay, de l’Argentine[17] et du Brésil[18]. Cela explique le retard dans la diffusion des idées socialistes et anarchistes parmi les travailleurs des campagnes et des villes. Il y avait aussi sans doute l’influence asservissante d’un clergé catholique particulièrement rétrograde et opposé, plus que dans d’autres républiques sud-américaines (et c’est peu dire), à tout changement dans les valeurs traditionnelles et dans la structure socio-économique.
Pourtant, alors qu’avant 1910, il n’existait ni syndicats ni sociétés de résistance (qui à cette date atteignaient leur développement maximal sous l’égide de l’idéologie anarchiste au Mexique, en Argentine, en Uruguay et au Brésil), les idées libertaires ne cessèrent de rouvert des adhérents et des sympathisants parmi les intellectuels et les écrivains dans les dernières années du XIXe siècle.
D’autant plus que, les 15 et 16 janvier 1893, il se produisit à Bogotá un soulèvement populaire qui ébranla les structures du pouvoir d’État et mit la ville aux mains du peuple travailleur, au moins durant deux jours. La première raison de l’insurrection (réprimée de manière sanglante par le gouvernement, causant plus de soixante-dix morts) fut l’indignation provoquée parmi les artisans par un article du journal catholique et officiel Colombia cristiana, dans lequel les associations d’artisans étaient dénigrées. En réalité il s’agissait d’une protestation contre les politiques libre-échangistes du gouvernement et contre l’inflation provoquée par l’émission sans contrôle de monnaie par l’État (comme l’insurrection de Caracas au Venezuela, qui eut lieu en 1989, après la prise de pouvoir par Carlos Andrés Pérez). Le représentant diplomatique de la France en Colombie signala que l’insurrection populaire comprenait un « mouvement anarchiste » organisé par la Société des artisans qui « proclamait les doctrines les plus subversives et révolutionnaires » et approuvait la propagande par le fait »[19].
Les tentatives d’organisation de communes anarchistes ne manquèrent pas en Colombie, comme au Chili, en Uruguay, au Brésil, etc. Elles n’eurent pas, dans la presse anarchiste européenne et latino-américaine, la notoriété de la colonie La Cecilia, fondée en avril 1890 par le vétérinaire italien Giovanni Rossi dans la province brésilienne du Paraná[20]. Jacinto Albarracín, journaliste originaire d’Arauca, fondateur de deux journaux combatifs, El Faro et La Razón del obrero, auteur de pièces de théâtre, comme Por el honor de una India et La hija del obrero, organisa une commune libertaire dans les forêts du Magdalena Medio, à laquelle il donna le nom d’Otanche. Cette commune, inspirée à la fois par les propositions de Kropotkine et de Reclus, fut détruite par les forces gouvernementales et n’eut pas une longue existence[21].
Juan Francisco Moncaleano fut une figure marquante du militantisme anarchiste aux débuts de notre siècle en Colombie (et dans d’autres pays latino-américains). Journaliste et professeur, il fonda à Bogotá, en 1 910, un organe de presse combatif, qui portait le titre significatif de Ravachol.
Les rédacteurs de ce périodique « se sentaient les héritiers d’une partie du legs laissé par Ravachol et de son exemple donné aux anarchistes » qui se signale « clairement quand, dans une louange à Ravachol, ils font allusion à « L’Idée », qui n’est rien d’autre que l e nom que les anarchistes donnaient à leur idéal libertaire »[22]. L’un des principaux objets de la critique véhémente de Ravachol était, logique dans un pays profondément soumis au pouvoir clérical, l’Église catholique, ses prêtres et ses évêques, ses institutions et ses rites, son prêche pour la soumission sociale et politique, sa pédagogie obsolète et autoritaire. Tout cela n’empêchait pas Moncaleano, comme presque tous les anarchistes de cette époque, d’avoir un profond respect et une grande admiration pour la figure de Jésus, dont il considérait les doctrines comme socialistes et libertaires. Dans un article publié dans Ravachol (22 août 1910), sous le titre de « Socialismo cristiano », il écrit : « Le christianisme a, en effet, gravé profondément dans nos cœurs et dans nos esprits, les sentiments et les idées qui donnent naissance au socialisme. Il est impossible de lire avec attention l’Ancien Testament et les Évangiles, et de jeter en même temps un œil sur les conditions actuelles, sans se voir obligé de les condamner au nom de l’idéal évangélique. Dans tout chrétien qui comprend les enseignements de son Maître et les prend au sérieux, il y a un fond de socialisme ; et tout socialiste, quelle que puisse être sa haine envers la religion, porte en lui un christianisme inconscient »[23].
L’un des collaborateurs du journal, Adelio Romero, nous éclaire dans le même numéro de Ravachol, avec un sonnet ; le sens qu’avait ici le mot « Socialisme » n’était rien d’autre que celui de « socialisme libertaire » ou « anarchisme ».
« Il est le cri immense qui vibre partout,
Il est un soleil de justice pour l’humanité,
Il est le noble combat que vigoureux, il livre
Le droit sublime contre l’iniquité.
Il est un bûcher immense d’égalité rédemptrice,
Qui brûlera les manteaux de la Rome pourrie.
C’est la force qui pousse avec la vérité créatrice
À défendre le saint droit de la vie.
Il est l’hymne guerrier des déshérités,
Dont les notes libres font mourir détrônés,
Les monarques olympiques à la grandeur obscure.
Et il est ainsi comme un baiser d’amour pour les parias
Pour les oppresseurs des castes millénaires,
Un fouet aux éclairs est brandi : l’Anarchie »[24].
Le sonnet d’Adelio Romero ne peut que rappeler, avec sa grandiloquence qui n’exclut pas des accents de profonde sincérité, les vers d’Alberto Ghiraldo, comme ceux qu’il a publiés cette même année 1910 (dans le volume Triunfos nuevos) à Buenos Aires, qui évoquent la Mère Anarchie[25] et ceux de Oiticica, de Martins Fontes ou de Sylvio Figueiredo au Brésil[26].
l’occasion du procès et de l’exécution du pédagogue catalan Francisco Ferrer dans le sinistre fort de Montjuich[27] il y eut dans tout le monde occidental[28] (en particulier en Espagne et en Amérique latine) une violente vague d’indignation et de protestation contre l’action criminelle militaro-cléricale[29]. Moncaleano adhère avec ferveur à cette campagne et il se propose de suivre l’exemple de Ferrer Guardia même jusqu’à l’échafaud : « Et si cette lutte en faveur de ma malheureuse patrie doit me mener demain au sacrifice de l’exil ou de l’échafaud, c’est-à-dire à ce Golgotha dans lequel fut immolé l’immortel Ferrer, je m’en irai ou je monterai tranquillement, comme ce martyr sublime »[30].
En fait, Moncaleano fut forcé à l’exil peu après. Il s’en alla aux États-Unis (Los Angeles), à Cuba et au Mexique. À Los Angeles, il publia à partir de 1911, un autre périodique anarchiste Pluma Roja[31]. Après avoir résidé quelques mois à Cuba, il arriva au Mexique, en pleine révolution anti-porfiriste. Se liant avec les anarcho-syndicalistes locaux, il fonda, le 22 juin 1912, aux côtés des militants actifs Jacinto Huitrón, Luis Méndez, Ciro Z. Esquivel, Pioquinto Roldán et Eloy Armenta, la Société anarchiste Luz qui, dès le 15 du mois suivant, fit paraître un journal du même nom. En même temps, il commença à travailler à la création d’une école rationaliste, sur le modèle de l’École moderne de Ferrer[32]. Le groupe Luz, d’accord avec les unions d’ouvriers carriers et ceux de l’industrie graphique, constitua, comme le dit Huitrón, « la pierre angulaire de la Casa del Obrero, qui deviendra plus tard un puissant mouvement syndical dans tout le pays »[33]. Il devait aussi jouer un rôle important dans la lutte armée pendant les conflits internes de la Révolution mexicaine grâce à la création des Bataillons rouges[34]. L’École patronnée par Moncaleano commença à fonctionner et fut l’une des nombreuses écoles qui se créèrent par la suite d’après les idées de Francisco Ferrer dans toute l’Amérique latine, depuis la ville de Mexico jusqu’à Rosario et Mendoza en Argentine.
Quelques figures de premier plan de la littérature colombienne eurent des rapports avec l’idéologie anarchiste. Parmi elles Vargas Vila, très célèbre par la suite, presque oublié aujourd’hui. Max Nettlau pense que dans ses œuvres on peut trouver « une grande abondance de documents sur la domination et ses victimes en Amérique latine ». Mais la plus grande partie de ses modèles littéraires pourraient difficilement se rattacher à l’anarchisme (Carlyle, Hello, Léon Bloy, etc.). En 1924 et 1925, on discutait beaucoup de la possible adhésion du romancier colombien à l’idéologie anarchiste[35]. En réalité, Vargas Vila semble plus proche de Nietzsche et de D’Annunzio que de la littérature libertaire. Rafael Barrett, critique indubitablement anarchiste et écrivain au style brillant et au goût incontestable, écrit au moment de se prononcer sur une poésie de Vargas Vila : « Rien de plus ennuyeux, plus faux, plus insignifiant ». Et jugeant le style de cet auteur, en général, il écrit : La « construction de Vargas Vila souffre d’une hypertrophie d’épithètes violentes et vides et d’antithèses disloquées. Cela ressemble à la gesticulation maniaque d’un alcoolique ». Mais il reconnaît aussi honnêtement que dans ses écrits « de temps en temps apparaît une beauté de bon aloi »[36].
Dans un autre article intitulé « Sur Vargas Vila et le décadentisme », il ajoute, d’une façon encore plus sévère et accablante, que l’œuvre de l’écrivain colombien (comparée à celles de Baudelaire, Verlaine ou Rubén Darío) l’ennuie, le blesse, l’afflige. Il pense que cette œuvre comporte une transposition illégitime et fausse :
« Cette masse de déchets, apportés de loin, et perdus en route, constitue un terrible foyer d’infection pour le bon goût »[37].
En tout cas, l’exaltation de l’art pour l’art comme valeur absolue, l’obsession érotique, la fantaisie lubrique et désespérée, ne sont sans doute pas des traits propres à la littérature anarchiste et socialiste de l’époque, bien qu’ils puissent provoquer les injures de beaucoup de critiques conservateurs[38].
Mais s’il est difficile de considérer Vargas Vila comme écrivain anarchiste, il est impossible de qualifier ainsi Guillermo Valencia, même si, comme le dit David Viñas, « son poème Anarkos (aussi populaire en ce moment que El tren expreso de Campoamor ou Las golondrinas de Bécquer à un autre moment historique) réussissait, en ayant recours à toutes les ressources de l’orateur libertaire, d’insolites adhésions massives »[39]. D’après Gómez Restrepo, la célèbre composition de Valencia rappelle Victor Hugo, et parmi les poètes de l’anarchisme latino-américain, il ne manque pas d’évoquer Alberto Ghiraldo :
« Ils sont les esclaves du pain : horde féconde
Qui remplit le monde des vaincus. Flamme
Avide de lécher. Tempête sourde
Qui gronde sur le Monde en folie.
Et ce sont leurs fils pâles légions
De fantômes qui dans la nuit dans leurs grottes,
Au rythme de leurs tristes cœurs,
Vivent en rêvant à des aurores nouvelles
D’un soleil d’amour dans l’aube mystique,
Et, sans que vienne la crise mensongère,
Au milieu de sa nichée misérable
Les épidémies de phtisie les égorgent ! »
Pourtant, l’auteur de « Anarkos », que les critiques ont l’habitude de considérer comme l’une des plus grandes voix lyriques de son époque[40] exprime rarement des penchants libertaires et, dans sa production poétique, on rencontre une grande variété de thèmes (Homère, Moïse, Alma Mater, la tristesse de Goethe, etc.) mais très peu de pièces dédiées aux hommes politiques, aux possédants et aux seigneurs, ce qui nous amène à penser que « Anarkos » est seulement un exercice poétique rhétorique en accord avec la mode du moment.
Ce n’est pas le cas de Vicente Lizcano, plus connu sous le pseudonyme significatif de Biófilo Panclasta. Né à Chinácota, dans le département de Santander, le 26 octobre 1879, fils d’une servante du palais épiscopal de Pamplona et d’un vagabond, il fit quelques années d’études secondaires dans un collège de Bucaramanga, mais il fut essentiellement un autodidacte, comme beaucoup d’anarchistes, car « il devait directement sa culture et ses idées de révolutionnaire anarchiste, jointes à ses sérieuses connaissances en géographie et en histoire, aux pages fraîches des brochures et des livres »[41].
Attiré dans sa jeunesse par les idéaux du libéralisme, il décida de s’exiler au Venezuela. Il fut d’abord professeur à Capacho, dans l’État de Táchira. Lorsqu’en 1898, Cipriano Castro prit les armes et partant des Andes se dirigea vers Caracas, il s’engagea dans les rangs de la Révolution restauratrice. Une fois Cipriano installé sur le fauteuil présidentiel, il devint son secrétaire particulier. Le jeune colombien essaya de rappeler au nouveau dictateur les idéaux proclamés (non seulement politiques mais aussi culturels et sociaux) du libéralisme, mais il semble qu’il n’ait pas eu beaucoup de succès. Quand le vice-président, Juan Vicente Gómez, caudillo du Táchira aussi cruel que Cipriano Castro mais plus ignorant et, en même temps, plus rusé que celui-ci, le destitua de la présidence (à l’occasion d’un voyage de son ami à l’étranger), Vicente Lizcano, fidèle à son chef Castro, fut emprisonné pendant un long moment. Une fois libéré, il partit et séjourna à Barcelone, la capitale de l’anarchisme ibérique de cette époque.
Là-bas, il devint un fervent partisan de « L’Idée » et changea son nom en « Panclasta » (du grec pan = tout et klasta = celui qui casse ou détruit). « Il se fit faire des cartes de visite en faisant mentionner sa condition d’anarchiste à une époque où ce vocable résonnait dans les oreilles tremblantes des bourgeois comme une explosion de dynamite. Les attentats terroristes étaient devenus à la mode et faisaient partie de la vie quotidienne des politiciens importants. Dès son arrivée à Barcelone, première ville européenne que foulèrent ses pieds vagabonds, l’anarchisme, devenu la profession définitive de Panclasta, commença à lui ouvrir les portes de toutes les prisons. Il fut expulsé de Barcelone. Il le fut aussi de Marseille. Il le fut des ports italiens, et de tous les ports de la Méditerranée. Quand on lui demandait son nom et sa profession, il répondait de manière invariable : « Panclasta, anarchiste », il aurait mieux valu à cette époque avoir dit : lépreux »[42].
Paris, il devint ami avec le fameux écrivain anarchiste E. Armand. Celui-ci le présenta à Lénine. Le révolutionnaire russe ne lui fit pas grande impression et il n’eut pas pour lui une grande estime. Plus tard, il l’apprécia encore moins, quand, alors au pouvoir, Lénine commença à montrer ses tendances centralistes et autoritaires. « Panclasta soutenait qu’il fallait lutter pour un idéal jusqu’à sa réalisation ; mais que, une fois45 réalisé, il fallait le détruire, et se battre avec acharnement pour une vie meilleure », écrit Carlos Lozano[43]. En réalité, il ne s’agissait pas exactement de cela, mais d’instaurer la révolution permanente, comme le souhaiterait par la suite Landauer (dans un sens différent, pourtant, de celui de Trotski).
En Italie, il fit aussi la connaissance de Maxime Gorki. Se promenant avec lui sur une plage de Sorrente, le jeune colombien se baissa pour libérer un mollusque coincé sous une pierre et il le rejeta à la mer ; le grand romancier russe, plein d’esprit, en fit ce commentaire : Tu ne devrais pas t’appeler « Panclasta » mais Biófilo »[44]. « Biófilo » signifie en grec « qui aime la vie » (bios = vivant ; philos = qui aime). C’est alors que son pseudonyme devint Biófilo Panclasta ce qui pourrait sembler être une contradiction mais n’en est pas une : Lizcano aimait toute forme de vie, et en particulier, de vie humaine (comme Kropotkine et tous les anarchistes de cette époque), et en même temps, précisément parce qu’il aimait la vie, il voulait détruire tout ce qui empêche son libre épanouissement et rend impossible son développement le plus élevé.
Il assista à Amsterdam au Congrès international anarchiste, où il rencontra sans doute Kropotkine, et il se présenta comme délégué des anarchistes colombiens. Au même moment, se tenait à La Haye un congrès international pour la paix, qui rassemblait des représentants de nombreux gouvernements du monde, (parmi ceux-ci Santiago Pérez Triana était le délégué de la Colombie). Biófilo Panclasta se dirige vers les participants : « Vous êtes envoyés par les gouvernements bourgeois du monde pour poser les bases de la paix, mais il ne sortira de vos démarches que des guerres innombrables et sanglantes. Nous, les anarchistes, représentants de tous les peuples opprimés de la Terre, nous venons à un congrès révolutionnaire et demandons le changement fondamental de l’ordre social et nous sommes ceux qui installons les principes de la paix universelle »[45].
Expulsé de Hollande, Biófilo arrive à Paris, où il rencontre Ravachol, qui avait fait sauter le ministère des Travaux publics***. Mais sa vocation révolutionnaire l’amena bientôt en Russie. À Saint-Pétersbourg, il se lie avec le pope Gapone et il s’en fallut de peu qu’il participe à la prise du palais d’Hiver. Après la révolution bolchevique, il est jugé et condamné à l’exil en Sibérie, où il est assigné à résidence dans le village samoyède de Shuskenoide, précisément là où Lénine avait résidé pendant l’un de ses nombreux exils. Gracié au bout d’un an, il retourne dans la capitale russe, et de là en Colombie, en passant par Barcelone et puis La Guaira au Venezuela. Il séjourna dans la zone bananière et « sur la place de Aracataca, il resta debout, imperturbable, pendant que les balles du général fauchaient des vies comme d’humbles moissons »[46].
Ses dernières années furent marquées par une profonde décadence : vivant avec Julia Ruiz, une ancienne nonne convertie en voyante anticléricale[47], il se consacra avec elle à la divination et à la chiromancie ; il sombra dans l’alcool et mourut le 1er mars 1942, à soixante-trois ans, dans un asile de Pamplona, au nord de Santander[48]. « Il nous resta de lui quelques ouvrages oubliés dans une bibliothèque, la poussière des années, les toiles d’araignées de vieux souvenirs, un vieux et vague portrait et une chevelure russe avec un regard de Santander, trouvés dans ce livre incomplet comme tout amour authentique de la vie »[49].
Sa pensée peut être résumée dans cette phrase qu’il a lui-même écrite : « la vie est l’unique et réelle vérité, la vivre est notre destin, la montrer nue est notre seul devoir ».
Le mouvement ouvrier commença à s’organiser en Colombie au cours de la seconde décennie du siècle, bien que le socialisme utopique et le proudhonisme fussent déjà liés, comme nous l’avons vu, « aux luttes desartisans contre les effets destructeurs du libéralisme »[50].
Il est évident que les premières grèves ouvrières de la décennie et les premières organisations syndicales furent l’œuvre des anarchistes. En 1913 fut créée l’Union Ouvrière.
Les anarchistes organisèrent une grande manifestation populaire de protestation le 15 mai 1916 et, selon Alfredo Gómez, ils organisèrent aussi le meeting des artisans qui se tint à Bogotá contre l’importation d’uniformes militaires.
Fanny Simon rapporte que des anarchistes colombiens ont participé à des journaux ouvriers d’Argentine et du Brésil dans ces années-là.
De son côté, Max Nettlau mentionne diverses publications sur le territoire colombien qu’il qualifie d’anarchistes. Certaines d’entre elles étaient des revues littéraires comme Trofeos, qui paraissait déjà à Bogotá en 1908, et Crepúsculos à Manizales, en 1910 et 1911. Mais d’autres étaient des organes de lutte ouvrière, comme El Obrero, éditée à Barranquilla entre 1912 et 1916 et dans lesquelles parurent de nombreux articles sur l’anarchisme et l’anarcho-syndicalisme. Dans son Historia del Partido comunista en Colombia, Medófilo Medina rappelle qu’en 1914, il fut publié dans ce périodique un article de Tomás Cerón Camargo dans lequel il critiquait l’apolitisme des anarcho-syndicalistes[51].
Selon Victor Alba, les anarchistes furent à l’origine de la grève du port de Carthagène en 1920[52]. En réalité, cette grève fut déclarée le 8 janvier 1918, et elle donna lieu à de violents affrontements entre les ouvriers et la police. La même année, il semble que des groupes anarcho-syndicalistes soient à l’origine d’autres grèves sur la côte atlantique. Le 2 janvier, un mouvement mené par les ouvriers du port commença à Barranquilla ; il y eut aussi des violences, un blocage de rues et la formation de groupes de combat, mais il se termina par une victoire des ouvriers qui obtinrent une augmentation de 50 % de leurs salaires. De même, la grève de solidarité menée par les ouvriers du port et les cheminots de Santa Marta, se termina par une augmentation des salaires de 25 %[53].
Le fait que ces premières grèves spécifiquement ouvrières se soient produites sur la côte atlantique est dû peut-être au fait que celle-ci « en raison de sa situation géographique était moins isolée que le reste dupays »[54].
Vers 1923, les travailleurs des plantations de bananes du département de Magdalena commencent à s’organiser (à Fundación, Aracataca, El Retén et sur le port de Santa Marta). La première grève contre l’United Fruit dans la zone bananière avait déjà éclaté en 1918. Cette organisation fut initiée à la base par des groupes anarchistes de la côte atlantique[55].
Comme en Argentine[56], au Chili[57] et au Mexique[58], les anarchistes lancèrent aussi en Colombie (et particulièrement à Barranquilla) une grève des locataires, dont le principal propagandiste fut le Péruvien Nicolás Gutarra, expulsé de Colombie en février 1924.
Le gouvernement promulgua en 1918 un décret, l’équivalent de la Loi de Résidence ratifiée par le gouvernement argentin en 1902 et de la Loi Gordo votée au Brésil en 1904, selon lesquelles les ouvriers étrangers participant à une grève pouvaient être emprisonnés ou exilés.
À cette époque, plusieurs figures du militantisme anarchiste se détachèrent du mouvement La Prosperida aldebe. Torres Giraldo (cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez) en mentionne plusieurs. Pepe Olózaga qui avait collaboré au Mexique avec le colonel Alberto Santa Fe et les frères Flores Magón. L’Italien Filipo Colombo et l’Espagnol Juan García qui étaient, semble-t-il, les initiateurs actifs du second congrès ouvrier et éditeurs du journal Adelante. Sur le littoral atlantique, plusieurs anarchistes européens (oubliés, peut-être volontairement, par Torres Giraldo pour ne pas faire du tort au rôle du marxisme représenté par le Parti socialiste révolutionnaire) militèrent avec énergie et eurent une participation active. L’Italien Genaro Toroni et l’Espagnol Abad Mariano Lacambra qui faisaient partie du Groupe libertaire de Santa Marta. Campo Elías Calderón de Santander qui, inspiré par l’idéologie anarcho-syndicaliste alors qu’il était ouvrier aux États-Unis (avec les IWW), organisa les mineurs des exploitations aurifères de Caldas et d’Antioquia ; et qui créa le noyau de la Fédération des mineurs d’Antioquia à l’origine de la première grève[59].
En Argentine, le premier congrès des sociétés ouvrières de résistance se réunit en 1901 et crée la FOA (Fédération Ouvrière Argentine)[60]. Le second eut lieu en 1902 (c’est là que l’UGT, socialiste marxiste se sépara de la FOA anarcho-syndicaliste)[61]. Le troisième se tint en 1903 et le quatrième en 1904[62]. La FOA changea alors de nom pour celui de FORA (Fédération Ouvrière Régionale Argentine), affirmant alors assez clairement son idéologie anarchiste[63]. Puis dès le cinquième congrès, ouvert le 26 août 1905, elle déclara approuver officiellement et solennellement cette idéologie et recommander à tous ses adhérents « la propagation et la connaissance la plus grande pour diffuser chez les ouvriers les principes économiques et philosophiques du communisme anarchiste »[64]. Pourtant, au neuvième congrès réuni le 1er avril 1915, elle se détacha de cette idéologie et proposa un syndicalisme neutre, bien qu’une grande partie de ses adhérents continuent de se considérer comme anarchistes[65].
En Colombie, un congrès ouvrier se réunit en 1919. Convoqué par le Syndicat Central Ouvrier, il avait une idéologie confuse, on y invoquait Bakounine et Malatesta et en même temps l’on refusait l’anarcho-syndicalisme. L’un de ses 500 participants, José D. Celis, manifesta, pourtant des idées anarcho-syndicalistes dans son intervention, en affirmant que dans la Société Ouvrière « nous ne ferons pas entrer nin’abriterons aucun partisan ni agent d’autres idées politiques qui ne soient pas les nôtres » et « nous essayerons de sauver l’ouvriérisme des politiques professionnels »[66]. Le premier Congrès ouvrier eut lieu le 1er mai 1924. Diverses tendances idéologiques s’y affrontent :
1) Les partisans de réformes du travail et de lois ouvrières, qui représentent surtout le Parti libéral (dans son aile gauche).
2) Les délégués du Parti socialiste révolutionnaire, fondé en 1919.
3) Les communistes débutants (qui répondent déjà aux directives de l’Internationale syndicale rouge).
4) Les anarcho-syndicalistes.
La première tendance paraît s’imposer (sans doute avec l’appui du gouvernement et du patronat). En conséquence, une Conférence socialiste, œuvre des délégués marxistes, se réunit parallèlement.
Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez font ce commentaire : « Devant l’absence de documents, il est assez difficile de déterminer avec précision l’attitude prise par les anarcho-syndicalistes, aussi bien au Congrès ouvrier que dans la Conférence socialiste. On peut supposer que Carlos F. León et Luis A. Rozo, directeurs du journal anarchiste La Voz popular et membres du Groupe Antorcha libertaria, principal cercle anarchiste présent au Congrès, restèrent en désaccord avec les deux projets, le libéral, majoritaire au Congrès ouvrier, et le marxiste, dans le Congrès communiste. Il semble qu’ils restèrent dans les deux congrès en tant qu’opposition minoritaire en nombre »[67].
Le second Congrès ouvrier commença le 20 juillet 1925. Le discours inaugural fut prononcé par Carlos F. León, qui avec Luis A. Rozo, faisait partie du groupe anarchiste Antorcha libertaria qui avait une certaine influence dans les syndicats de Bogotá. C’est au cours de ce congrès que fut mise en évidence — comme le disent Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez — la participation anarcho-syndicaliste. « Les anarchistes avaient préparé un projet d’organisation ouvrière au niveau national, inspiré par l’Union Syndicale Argentine, qui, présenté en séance plénière du Congrès, suscita d’intenses polémiques et réflexions »[68].
Il faut néanmoins signaler que la FORA du cinquième congrès était en 1925 en Argentine une organisation ouvrière spécifiquement anarchiste. L’Union Syndicale Argentine (USA) était le résultat d’une fusion entre la FORA du neuvième congrès et quelques syndicats de la FORA du cinquième congrès, dominés par les anarcho-bolchevistes. Après le coup d’État fasciste du général Uriburu en 1930, l’USA (où militaient encore quelques anarchistes) fusionna à la fois avec la COA (Confédération Ouvrière Argentine), dominée par les socialistes réformistes, et donna naissance à la CGT (Confédération Générale du Travail), principal instrument à partir de 1943, de la politique ouvrière du péronisme.
Carlos F. León, en tout état de cause, s’attaqua dans son discours à la présence de partis politiques dans les organisations ouvrières et en même temps défendit la thèse anarcho-syndicaliste qui considère les syndicats comme les bases de la société future et proposa les lignes générales d’une organisation ouvrière fédéraliste où les décisions devaient venir de la base et des groupes locaux.
Pendant le congrès, on assista à d’ardents débats politiques entre les anarchistes et les marxistes qui étaient appelés par les premiers « les dévots de saint Lénine » et qui leur reprochaient déjà l’instauration de la dictature rouge en URSS[69].
De ce congrès naquit la CON, centrale ouvrière organisée plutôt sur le modèle marxiste et qui ne tarda pas à s’affilier à l’Internationale Syndicale Rouge (bolchevique), mais les anarchistes ne cessèrent pas d’y exercer, malgré tout, une certaine influence et empêchèrent la création d’un parti politique de la classe ouvrière, projet essentiel pour tous les léninistes du monde.
Le 21 novembre 1926 s’ouvrit à Bogotá le troisième Congrès ouvrier sous la présidence du marxiste Ignacio Torres Giraldo et sous la seconde vice-présidence de l’anarchiste Raúl Eduardo Mahecha Caycedo. « Aucours de ce congrès la rupture définitive entre marxistes et anarcho-syndicalistes est entérinée car les marxistes parviennent à imposer la création du Parti socialiste révolutionnaire, le PSR »[70].
Quand les marxistes présentent le projet de création de ce parti, « les anarchistes du groupe Antorcha Libertaria » menés par Carlos F. León et Luis A. Rozo et d’autres groupes sympathisants de l’anarchisme, comme celui animé par Juan de Dios Romero, s’opposent de manière tranchante à cette initiative. Des débats violents et enflammés ont lieu à ce sujet et entraînent un accroissement du sectarisme de certains groupes ; Romero et Erasmo Valencia annoncèrent leur retrait des débats qui avaient pour sujet la formation du parti « parce qu’ils estimaient que tout parti politique devient préjudiciable à l’action économique du syndicalisme et aux principes de la notion de classes nécessaires à la revendication du peuple colombien »[71].
Malgré la victoire du projet marxiste, le PSR ne parvint jamais à être un parti ressemblant à l’image du Parti communiste (bolchevique) d’URSS ou des partis communistes apparus dans divers pays d’Amérique latine à cette époque (Argentine, Uruguay, Brésil, Chili, etc.). Il y avait en son sein un mélange d’idéologies et de projets ; des libéraux de l’aile radicale comme Uribe Márquez, des communistes comme Torres Giraldo, te même des anarchistes, comme Mahecha Caycedo y militaient. « Le PSR avait une tendance anarchiste importante qui pouvait se voir dans la constitution du parti lui-même formé de masses et non de cadres, qui était fédératif avec un respect des autonomies régionales et par conséquent non centraliste »[72].
Alfredo Gómez est enclin à confirmer cette interprétation quand il dit (en citant Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez) : « La prédominance d’un syndicat de type révolutionnaire pendant cette décennie, inspiré ou non par l’anarcho-syndicalisme, imprime au PSR, dans certains cas, des éléments de l’organisation libertaire : autonomie locale, formes d’action directe, ignorance des institutions en place, etc. Dans ce sens, le PSR a de manière spontanée et embryonnaire une structure d’«antiparti », qui ne manque pas de similarités avec le Parti libéral de la Révolution mexicaine »[73]. Mais il est indéniable que le Parti libéral mexicain, surtout à partir de 1906, n’est ni « libéral » ni même un « parti » mais bien une organisation anarchiste[74].
On pourrait dire la même chose, à une époque plus récente, du PVP uruguayen. Il est certain que les anarchistes participèrent à la majorité des mouvements de luttes et des grèves qui eurent lieu en Colombie entre 1910 et 1930. Ils furent présents dans celle de Barranquilla en 1910 ; dans le large mouvement qui s’est développé en 1918 à Carthagène, Barranquilla et Santa Marta ; dans la première grève contre la tristement célèbre compagnie United Fruit, dans la zone bananière de Santa Marta, en 1918 ; dans la grève des chemins de fer de Girardot et dans celle des ouvriers et des artisans de Bogotá en 1919 ; dans celles de Barrancabermeja en 1924 et 1927 contre la compagnie Tropical Oil (qui se terminèrent par l’expulsion de 1200 ouvriers et un procès militaire contre les meneurs), dans la seconde grève de Santa Marta, en 1928, qui se termina par un massacre de travailleurs, et dans de nombreuses autres grèves et mouvements de protestation populaire[75].
À Barrancabermeja, deux grèves éclatèrent successivement : la première en octobre 1924 et la seconde en janvier 1927. Elles étaient toutes les deux dirigées contre la compagnie Tropical Oil, filiale de la Standard Oil. Dans la première grève, Mahecha Caycedo et ses compagnons anarcho-syndicalistes de la Société Ouvrière jouèrent un rôle important, ainsi que le journal La Voz popular, qui était de la même tendance[76]. Dans la seconde grève, qui prit des dimensions extraordinaires et qui compta sur l’appui de tous les travailleurs, ainsi que des agriculteurs et des commerçants locaux, il semble qu’il y ait eu un certain spontanéisme, mais on ne peut nier l’intervention active de Mahecha Caycedo lui-même et d’autres anarchistes. Les mouvements de grève qui ont eu lieu à Bogotá pendant le mois de novembre 1924 contre l’entreprise Energía eléctrica et contre la compagnie de ciments Samper, eurent leur quartier général à la Maison du Peuple, siège du groupe anarcho-syndicaliste Antorcha libertaria. Les rédacteurs de La Vozpopular appelaient même à la grève générale. La grève des bananeraies de 1928 eut encore plus d’écho, le rôle des anarchistes fut indiscutablement de premier plan.
À ce propos, Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez écrivent : « Les ouvriers anarchistes du Groupe libertaire de Santa Marta comme entre autres, Mariano Lacambra, Genaro Toroni, Nicolás Betancourt, José Garibaldi Russo et Castilla Villareal, ont joué un rôle significatif dans l’agitation et dans l’organisation de la grève des employés des bananeraies contre la compagnie United Fruit en 1928. Ces anarcho-syndicalistes, suivant les orientations des centrales anarchistes catalanes, fondèrent vers 1925 à Guacamayal, l’Union Syndicale des Travailleurs du Département de Magdalena, USTM, et une Maison du Peuple où les ouvriers de la région se réunissaient pendant la nuit. L’USTM comportait soixante-trois syndicats. Mahecha Caycedo jouait un rôle prépondérant dans l’organisation et depuis longtemps il avait préparé de manière efficace le mouvement de grève dans les pages de son journal Vanguardia obrera. La participation anarchiste à l’organisation et au développement de la grève des bananeraies est rapportée par les historiens officiels et marxistes. Depuis longtemps, les anarchistes avaient préparé les masses, menant à bien un travail de conscientisation, d’éducation et d’agitation, non seulement dans la région mais aussi sur toute la côte atlantique où l’anarcho-syndicalisme s’était bien enraciné dans divers secteur ouvriers et populaires. Sur la côte atlantique, les anarchistes étaient présents dans diverses organisations ouvrières, fortes et représentatives, parmi lesquelles on peut mentionner la Fédération Ouvrière du Littoral Atlantique, FOLA, créée à l’initiative du collectif libertaire Via libre ainsi que l’USTM, déjà mentionnée »[77].
Devant le refus de l’United Fruit de répondre aux demandes des travailleurs regroupés dans l’USTM, le 12 novembre 1928, environ trente mille ouvriers proclament la grève générale. Au début du mois de décembre, le gouvernement national décrète l’état de siège dans la région, y nomme comme chef civil et militaire le général Carlos Cortés Vargas et y envoie des troupes depuis Carthagène, Barranquilla, Bucaramanga et Medellín. La grève s’achève par un énorme massacre de grévistes le 6 décembre sur la place de Ciénaga suivi d’une sanglante répression, qui provoquèrent 1500 morts au total. « La troupe donnel’assaut, viole, pille. Elle emprisonne les civils, exigeant d’eux de l’argent pour leur libération, distribue les amendes, recouvre des impôts, envoie aux travaux forcés, achève les blessés, torture et fusille »[78].
Cette réaction brutale et meurtrière de l’armée colombienne rappelle les événements survenus en Patagonie argentine en 1921 quand l’armée nationale assassina des milliers d’ouvriers agricoles et de travailleurs ruraux, organisés dans la centrale anarchiste (FORA), sur l’ordre du lieutenant-colonel Varela[79], exécuté le 23 janvier 1928 par Kurt Wilckens[80].
Mais, comme le font bien remarquer Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, « pour le mouvement ouvrier colombien, les conséquences de la grève furent un coup dur. De son côté, sans illusions, il abandonna sa combativité et la radicalité de ses revendications et de ses prétentions et il accepta de participer aux instances légales, en entrant dans le Parti libéral ; par ailleurs, les syndicats perdirent leur sens véritable, pour se transformer en appendices de l’État. Les conséquences de ce recul se perçoivent clairement dans la crise actuelle du mouvement ouvrier et syndical qui choisit l’institutionnalisation. Le dénouement de la grève asséna un coup de grâce aux cercles anarcho-syndicalistes colombiens. Devant la réaffirmation des valeurs éthiques, économiques, sociologiques, juridiques de la société bourgeoise, devant la grande centralisation étatique qui commença à apparaître, ces cercles et ces collectifs se trouvèrent chaque fois plus isolés et impuissants pour y faire face. Peu à peu ils se disloqueront jusqu’à perdre toute influence. Le milieu libéral remporta momentanément la bataille. Vers 1930, Archila Neira nous raconte que le courant anarcho-syndicaliste fut reconnu lors du congrès de fondation de la Centrale des Travailleurs de Colombie et l’un des quinze postes de la « direction » lui fut octroyé, mais au congrès suivant ce courant n’eut pas de délégués »[81].
Cette évolution n’a aucun parallèle au Venezuela, bien qu’on ne puisse écarter quelque influence des syndicats anarchistes du pétrole de la région de Barrancabermeja sur l’organisation naissante et presque clandestine des ouvriers du pétrole de l’État de Zulia (influencés ensuite, sans doute, par les anarcho-syndicalistes nord-américains des IWW).
L’évolution en Colombie a pourtant de curieux parallèles avec celle de l’Argentine. La sanglante répression des ouvriers de la banane fut décidée en Colombie par un gouvernement libéral et celle des travailleurs agricoles de Patagonie par un gouvernement radical. Par ailleurs, les bénéficiaires de la décadence du syndicalisme révolutionnaire anarchiste furent le Parti libéral et le Parti communiste en Colombie et le péronisme et la gauche marxiste-léniniste en Argentine. Mais le coup le plus dur porté à la FORA provint en 1930 du fascisme du général Uriburu (dans les rangs duquel militait par ailleurs Perón).
Pendant les années 1920, divers périodiques anarchistes furent publiés. Parmi ceux-ci, Max Nettlau se souvient d’Organización , édité à Santa Marta en 1925, et de Vía libre à Barranquilla en 1926[82]. En réalité, celui-ci commença à paraître en 1925. Son directeur était Gregorio Caviedes. Dans le no2, qui parut le 10 octobre de cette année, nous trouvons, en première page, un article intitulé « L’Anarchie », « Anarchie ! Vocable sublime ! Voix douce et grandiose ! Idée magnifique, pure, belle ! Anarchie ! Vocable salué et présenté par les grands penseurs ! Concept hautement humain ! Idéal fraternel, altier, juste ! Idéal ou jours victorieux, invaincu ! Anarchie ! Vocable qui renferme un monde de beautés ! Science ! Revendication ! Révolution ! Réalité ! Anarchie ! Motif de Paix, d’Amour, d’Égalité, de Solidarité, de Liberté, de Terre ! Ô doux vocable ! Anarchie ! Les expressions manquent vraiment pour traduire le sens sublime que renferme ce mot, impertinent, éminent, beau, immensément beau ! Il faut avoir un grand esprit, libre, il faut posséder des sentiments nobles, il faut avoir un cœur humain, essentiellement humain, pour pouvoir comprendre dans toute sa splendeur et grandeur le sublime de l’Anarchie » et après cette exaltation qui, aujourd’hui, peut paraître rhétorique et déclamatoire, il explique : « Anarchie signifie en premier lieu sans gouvernement ; abolition de l’État ou état social dans lequel il n’y a pas de Pouvoir autoritaire. Vie libre, sans Dieu ni Maître. C’est cela l’Anarchie ! » Un peu plus loin, contre ceux qui soutiennent que « la réalisation de l’Anarchie ne sera possible que dans une humanité née pour l’altruisme et la philanthropie », il rétorque :
Une chose bien connue est que l’homme s’adapte au milieu. Une société basée sur l’inégalité sociale et par conséquent le despotisme, engendrera de manière irrémédiable, des hommes sans sentiments de fraternité et de solidarité. Mais une société basée sur l’égalité amènera un maximum de fraternité, et par conséquence, le bien-être général sera un fait ».
L’influence de Kropotkine paraît ici suffisamment claire. De manière curieuse, à l’encontre de la pratique universelle de la presse anarchiste dans le monde, Vía libre publie quelques annonces commerciales. Pour cela, elle se croit obligée de donner l’explication suivante : « Nous espérons que nos compagnons anarchistes nous excuseront d’avoir pris la décision d’accepter des annonces dans notre feuille. Oui, compagnons, avant de condamner notre conduite, venez à nos côtés, installez-vous dans ce milieu et après… Ce peuple ne lit pas, il ne sent pas cette nécessité si humaine, nous a dit quelqu’un avec raison ».
Cette même année 1925, le groupe syndicaliste Antorcha Libertaria publie à Bogotá Voz popular, périodique auquel participent notamment Pedro E. Rojas, Gerardo Gómez, Carlos F. León. Mais, selon Archila Neira, en 1925 également à Bogotá, paraissent divers autres organes de presse anarchistes et anarcho-syndicalistes : Pensamiento y voluntad,La Antorcha, El Sindicalista, etc.
D’après Torres Giraldo, la grève des chauffeurs déclenchée dans la capitale colombienne le 21 mars 1927 fut d’inspiration anarchiste, mais le plus remarquable, c’est qu’une autre grève du même syndicat éclata dans la même ville le 18 février 1937 alors que Jorge Eliécer Gaitán était maire, elle fut aussi d’inspiration anarchiste[83].
Divers syndicats d’ouvriers et d’artisans apparaissent pendant les années 1920, comme celui des tailleurs et celui des scieurs à Barranquilla qui se proclame nt de manière explicite « libertaires », sous l’inspiration de l’anarchiste Víctor Medina, avec lequel collaboraient deux anarchistes guatémaltèques[84]. Ces derniers, installés dans la cité colombienne atlantique, avaient fait probablement partie du groupe qui publiait dans la ville de Guatemala le périodique Orientación sindicalista qui défendait l’action directe contre tout parti politique et du comité Pro acción sindical fondé dans la capitale centre-américaine par un groupe d’anarchistes espagnols, péruviens et guatémaltèques[85]. Ce comité fut dissous par la dictature militaire en 1937[86].
Pendant les années 1920, il y eut en Colombie des figures remarquables de militants anarchistes qui consacrèrent leur vie à l’organisation et à la lutte des travailleurs des villes et des campagnes, comme Raúl Eduardo Mahecha Caycedo et Juan de Dios Romero.
Mais l’échec de la grève de la banane et le développement de la propagande bolchevique, subventionnée généreusement par l’Union Soviétique, entraînèrent dans les années 1930 un déclin des idées anarchiste.
Les guérillas rurales, phénomène colombien depuis les années 1950, sont venues d’une révolte libérale contre le gouvernement conservateur, mais elles vont acquérir ensuite une idéologie et une mentalité marxistes, surtout après la victoire de la révolution cubaine. Parmi les divers groupes rebelles armés, certains étaient de fidèle obédience moscovite, d’autres étaient guévaristes, maoïstes ou trotskistes. Les mouvements indigénistes et nationalistes de gauche ne manquèrent pas non plus. Mais l’influence anarchiste fut pratiquement nulle. Pourtant, ces dernières années, quelques petits noyaux insurgés se sont définis comme anarchistes », mais ils ne l’étaient peut-être pas. En revanche, on peut remarquer de nos jours l’existence de divers groupes d’artistes, d’intellectuels et d’étudiants, actifs à Bogotá, Cali et d’autres villes colombiennes et qui se considèrent avec raison comme anarchistes. Nous ne savons pas si leur activité s’est étendue dans les syndicats et les sociétés ouvrières.
Dans le « Magazín dominical » d’El Espectador, l’un des principaux journaux colombiens, sont apparus à plusieurs reprises, lors de la dernière décennie, des articles sur l’anarchisme. Ainsi, dans le no 70 du 29 juillet 1984, est parue une interview de Jean-Paul Sartre réalisée en 1979 sous le titre de « Anarchie et morale », traduite par Alfredo Gómez Muller ; dans le no 363 du 8 avril 1990, une lettre de Bakounine sur l’amour libre a été publiée ; dans le no 444 du 27 octobre 1991 est paru un article d’Iván Darío Álvarez, intitulé « L’anarchie comme mythe de la liberté » et enfin, dans le no 463 du 8 mars 1990, a été publié un honnête « Dossier de l’anarchie » qui comprend des textes de l’anarchiste français Anselme Bellegarrigue, de l’allemand Rudolf Rocker, du péruvien Manuel González Prada, de l’hispano-paraguayen Rafael Barret, ainsi que des articles de Mijal Levi sur « Kafka et l’anarchisme », d’Iván Darío Álvarez sur « Notre anarchie de tous les jours », de Leopoldo Múnera : « Le loup et les moutons », etc. Ainsi qu’une poésie de Boris Vian : « Le déserteur » et une bibliographie de base sur l’anarchisme.
Traduction de Felip Equy
NOTES
* Source : Actual no 29, Mérida, mai-août 1994, p. 31-64.
** Ángel J. Cappelletti (1927-1995). Philosophe, historien et anarchiste argentin, il résida pendant de nombreuses années au Venezuela. Il est né et mort à Rosario (Argentine), mais les 27 années qu’il passa au Venezuela, entre 1968 et 1994, la plus grande partie d’entre elles comme professeur titulaire à l’université Simón Bolívar, furent les plus prolifiques pour leur production intellectuelle et universitaire, étant donné qu’il publia de son vivant environ 45 livres — et au total 80, car après sa mort les universités de Los Andes et Simón Bolívar ont publié des travaux inédits de l’auteur — et plus d’un millier d’articles sur des sujets philosophiques et littéraires.
[1] – E. H. Carr, Bakunin, Barcelona, 1970, p. 258-259.
[2] – Max Nettlau, «Viaje libertario a través de América Latina», Reconstruir no 77, p. 39.
[3] – Juan Carlos Gamboa Martínez et Amadeo Clavijo Ramírez, Participación del anarquismo y del anarcosindicalismo en las organizaciones y luchas obreras en Colombia durante la década de los veinte, version résumée d’une thèse de licence en sciences sociales, Universidad pedagógica nacional, Bogotá, 1988, p. 1.
[4] – Enrique Valencia, «El movimiento obrero colombiano», Pablo González Casanova, Historia del movimiento obrero en América Latina, México, 1984, p. 3-13.
[5] – Manuel Díaz Rodríguez, Sangre patricia, Caracas, 1972, p. 77.
[6] – Federico Brito Figueroa, Tiempo de Ezequiel Zamora, Caracas, 1981, p. 32-56.
[7] – Ibíd., p. 239.
[8] – Ibíd., p. 346.
[9] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 2.
[10] – Miguel Urrutia Montoya, Historia del sindicalismo en Colombia, Bogotá, 1969, p. 48, cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[11] – Cf. José C. Valadés, Don Melchor Ocampo, reformador de México, México, 1954.
[12] – Gastón García Cantú, El socialismo en México – Siglo XX, México, 1986, p. 112-113.
[13] – Ignacio Ortiz, Pensamiento de Plotino C. Rhodakanaty, thèse de licence, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, inédite, p. 16-17.
[14] – Juan Hernández Luna, «Movimiento anarco-fourierista entre el Imperio y la Reforma», Cuadernos de orientación política, avril 1956.
[15] – Alfredo Gómez Muller, Anarquismo y anarcosindicalismo en América Latina, Barcelona, 1980, p. 14, cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[16] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 2-3.
[17] – Cf. Diego Abad de Santillán, El movimiento anarquista, Buenos Aires, 1910, p. 31 ; Gastón Gori, Inmigración y colonización en la Argentina, Buenos Aires, 1964 ; I. Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, 1978, p. 20.
[18] – Cf. Zelia Gattai. Anarquista, graças a Deus, Rio de Janeiro, 1979 ; P. Avrich, «Los anarquistas de Brasil», Reconstruir, no 100 ; J.W. Foster Dulles, Anarquistas e comunistas no Brasil (1900- 1935), Rio de Janeiro, 1977, p. 17 ; J. Grossi, Storia della colonizazione europea al Brasile e della emigrazione italiana nello stato di Sáo Paulo, Milano, 1914.
[19] – Cf. Álvaro Tirado Mejía, Aspectos sociales de las guerras civiles en Colombia. Bogotá, 1976, p. 464-465, cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[20] – Cf. Alfonso Schmidt, Colonia Cecilia: romance de una experiencia anarquista, São Paulo, 1980 ; Newton Stadler de Souza, O anarquismo da Colonia Cecilia, Rio de Janeiro, 1970.
[21] – J. A. Osorio Lizarazo, «La vida extraordinaria de Jacinto Albarracín, el primero que en América ensayó un gobierno de soviet», Novelas y Crónicas , Bogotá, 1978, p. 426-434.
[22] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 6.
[23] – Ibíd. p. 7.
[24] – Ibíd. p. 8.
[25] – A. Ghiraldo, Triunfos nuevos, Buenos Aires, 1910.
[26] – J. Oiticica, «Aos companheiros de prisão», A Plebe, 5 marso 1919 ; Martins Fontes, Vulcáo Santos, 1920 ; Sylvio Figueiredo, «Os Grevistas», A Voz do Povo, Rio de Janeiro, 2 febrero 1920.
[27] – Cf. Joan Conelly Ullman, La semana trágica: estudios sobre las causas del anticlericalismo en España (1898-1912), Barcelona, 1972, p. 528.
[28] – Lapouge-Bécaraud, Los anarquistas españoles, Barcelona, 1977, p. 70.
[29] – Diego Abad de Santillán, La FORA, Buenos Aires, 1971, p. 70 ; J. W. Foster Dulles, Anarquistas e comunistas no Brasil (1900-1935), Rio de Janeiro, 1977.
[30] – Juan Francisco Moncaleano, «Memorial», Ravachol, 7 octubre 1910, cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[31] – Max Nettlau, «Viaje libertario», Reconstruir, no 77, p. 40.
[32] – Jacinto Huitrón, Orígenes e historia del movimiento obrero en México, 1980, p. 198-199.
[33] – Jacinto Huitrón, op. cit., p. 209.
[34] – Jacinto Huitrón, op. cit., p. 263.
[35] – Max Nettlau, «Viaje libertario», Reconstruir, no 77, p. 40.
[36] – Rafael Barrett, Obras completas, Buenos Aires, 1954, vol. III, p. 171.
[37] – Ibíd., vol. III, p. 175-176.
[38] – Cf. Antonio Curcio Altamar, Evolución de la novela en Colombia, Bogotá, 1957, p. 197-202.
[39] – David Viñas, Anarquistas en América Latina, México, 1983, p. 105.
[40] – J. Ortega, Historia de la literatura colombiana, Bogotá, 1935, p. 809 sqq.
[41] – Carlos Lozano, «Biófilo Panclasta, una historia sin alas», Credencial, no 35, octubre 1989.
[42] – J. A. Osorio Lizarazo. «Biófilo Panclasta, el anarquista colombiano, amigo y compañero de Lenin, que conoció los honores de la estepa siberiana», El Tiempo, Bogotá, 12 febrero 1939.
[43] – Carlos Lozano, op. cit.
[44] – Ibíd.
[45] – J. A. Osorio Lizarazo, op. cit.
*** Note du traducteur : Cette biographie de Biófilo Panclasta semble truffée d’incohérences. Voici deux exemples. Il ne peut avoir rencontré Ravachol après le Congrès d’Amsterdam (1907) car celui-ci avait été guillotiné en 1892. Le pope Gapone, un agent de la police secrète tsariste n’a rien à voir avec la Révolution de 1917 mais avec celle de 1905.
[46] – Carlos Lozano, op. cit.
[47] – J. A. Osorio Lizarazo, «La vida misteriosa y sencilla de Julia Ruiz», El Tiempo, Bogotá, 5 febrero 1939.
[48] – Gonzalo Buenahora parle de Biófilo Panclasta dans son roman (ou mieux, son récit social) Sangre y petróleo. Le Centre culturel Gabriel García Márquez a monté sous la direction de José Assad une pièce de théâtre intitulée Biófilo. Le projet culturel Alas de Xué a fixé, sur l’Universidad pedagógica nacional, de Bogotá, une plaque : « À la présence toujours renouvelée de la pensée de Biófilo Panclasta, Vicente Lizcano ».
[49] – Iván Darío Álvarez, «A Biófilo: el jardinero del desierto; A Panclasta: el flautista de una leyenda», Revista Materi-Leri-Lero, no 7, junio 1986, Bogotá, p. 38-39.
[50] – Enrique Valencia, «El movimiento obrero colombiano», Pablo González Casanova, Historia del movimiento obrero en América Latina: 3, p. 13.
[51] – Cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[52] – Víctor Alba, Historia del movimiento obrero en América Latina, México, 1964, p. 105.
[53] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 12-13.
[54] – Álvaro Tirado Mejía, Colombia: siglo y medio de bipartidismo, 1978, cité par David Viñas.
[55] – Ignacio Torres Giraldo, Los inconformes: historia de la rebeldía de las masas en Colombia, Bogotá, 1978, vol. III, p. 717, cité par Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez.
[56] – F. Quesada, «La Protesta: una longeva voz libertaria», Todo es Historia, no 82, p. 87.
[57] – La Protesta, no 1136, Buenos Aires, 1925.
[58] – John M. Hart, El anarquismo y la clase obrera mexicana: 1880-1931, México, p. 208-211 ; Octavio García Mundo, El movimiento inquilinario de Veracruz, 1922, México, 1926, p. 53 ; Paco Ignacio Taibo II et Rogelio Vizcaíno, Memoria roja, México, 1984, p. 147-183.
[59] – Ignacio Torres Giraldo, op. cit., vol. III, p. 717 et 740.
[60] – Diego Abad de Santillán, La FORA: ideología y trayectoria, Buenos Aires, 1971, p. 67 ; Julio Godio, Historia del movimiento obrero latinoamericano, Caracas, 1985, vol. I, p. 188-189.
[61] – Diego Abad de Santillán, op. cit., p. 93 ; Julio Godio, op. cit.,vol. I, p. 190.
[62] – Diego Abad de Santillán, op. cit., p. 115-120 ; Antonio López, La FORA en el movimiento obrero. Buenos Aires, 1982, vol. I, p. 13.
[63] – Iaacov Oved, El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina, México, 1978, p. 356-363.
[64] – ] Diego Abad de Santillán, op. cit., p. 142 ; Julio Godio, op. cit.,vol. I, p. 201.
[65] – E. López Arango et Diego Abad de Santillán, El anarquismo en el movimiento obrero, Barcelone,1925, p. 28-29 ; Cf. Sebastián Marotta, El movimiento sindical argentino, su génesis y desarrollo, Buenos Aires, 1960-1961.
[66] – Miguel Urrutia Montoya, op. cit., p. 90-91.
[67] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 18.
[68] – Ibíd. p. 19.
[69] – Alfredo Gómez Muller, op. cit., p. 57.
[70] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 21.
[71] – Ibíd. p. 22.
[72] – Ibíd. pp. 22-23.
[73] – Alfredo Gómez Muller, op. cit., p. 73.
[74] – Chantal López et Omar Cortez, El programa del Partido Liberal mexicano de 1906 y sus antecedentes, México, 1985.
[75] – Álvaro Tirado Mejía, op. cit., cité par David Viñas.
[76] – Alfredo Gómez Muller, op. cit., p. 44.
[77] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., pp. 30-31.
[78] – Ibíd. p. 32.
[79] – Oswaldo Bayer, Los vengadores de la Patagonia trágica, Buenos Aires, 1972-1974 ; Federación obrera local bonaerense, La Patagonia trágica, Buenos Aires, 1922.
[80] – «Causas y efectos: la tragedia de la Patagonia y el gesto de Kurt Wilckens», supplément de La Protesta, 31 janvier 1929 ; R. González Pacheco, Carteles, Buenos Aires, 1956, vol. II, p. 116.
[81] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 33.
[82] – Max Nettlau, «Viaje libertario», Reconstruir, no 77, p. 39.
[83] – Gamboa Martínez et Clavijo Ramírez, op. cit., p. 33-34.
[84] – Ibíd. p. 34.
[85] – José Luis Balcárcel, «El movimiento obrero en Guatemala», Pablo González Casanova. Historia del movimiento obrero en América Latina: 2., p. 131.
[86] – Max Nettlau, «Viaje libertario», Reconstruir, no 78, p. 42.