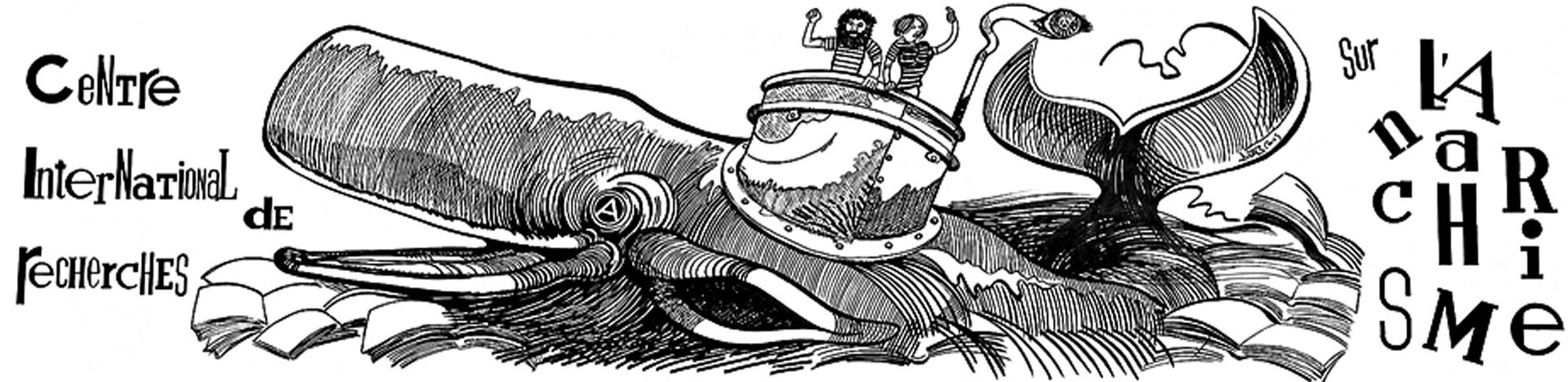De Rivista Malamente n. 30, sept. 2023 : source en italien
traduit en français à partir du texte italien de Martina Guerrini
Annie Le Brun (1942) est une poète, écrivaine et critique littéraire surréaliste française. Elle rencontre André Breton à vingt et un ans et participe aux activités du mouvement surréaliste de 1963 jusqu’aux dernières années précédant l’autodissolution du groupe. Elle était la compagne de vie du poète, dramaturge et traducteur surréaliste croate Radovan Ivšić, décédé en 2009. Nous publions son discours à l’occasion du séminaire « Images contre l’imagination : la marchandisation du sensible », tenu le 3 mai 2023 à l’Académie des Beaux-Arts de Rome ; la transcription et la traduction en italien sont l’œuvre de Martina Guerrini (qui a traduit et édité le volume d’Annie Le Brun « L’excès de réalité. La marchandisation du sensible », BFS, 2010).

Sans aucun doute, comme vous, je n’ai jamais cessé d’être fascinée par les images, c’est pourquoi j’en suis venue à m’inquiéter du rôle qui leur est réservé dans le monde numérique, car elles ferment les horizons qu’ils s’ouvraient auparavant. Cependant, si l’origine de mon activité critique n’était pas plus poétique que politique, je n’aurais pas mesuré l’importance vitale des enjeux. C’est-à-dire que le capital, toujours à la recherche de nouveaux profits, après avoir exploité la surface et les profondeurs du monde, était en train d’attaquer notre vie intérieure.
Ce sont les étapes de cette marchandisation du sensible que je souhaite évoquer ici, ainsi que le rôle croissant de l’image dans cette sombre histoire, dont dépend le peu de liberté qui nous reste. Cela m’amènera à reprendre le parcours critique que j’ai développé à travers trois essais successifs, Du trop de réalité, Ce qui n’a pas de prix et Ceci tuera cela, écrit en collaboration avec Juri Armanda.
« En matière de révolte, aucun d’entre nous ne doit avoir besoin d’ancêtres », écrivait André Breton en 1928. Si je ne devais conserver qu’une seule phrase de tout le surréalisme, paradoxalement, je choisirais celle-ci. Parce qu’elle révèle la singularité nécessaire de cette révolte, dont dépend la montée ou non de tout ce qui compte, que ce soit la poésie ou l’amour, mais aussi le sens que chacun de nous cherche à donner à sa vie.
Il y a quelque temps, je me suis demandé pourquoi les enfants aiment tant les contes de fées et pourquoi, même à l’âge adulte, nous en gardons un souvenir enchanté. Je dirais que le vrai secret des contes de fées est de commencer par « Il était une fois », car, en commençant toujours par cette phrase, ils affirment la singularité des êtres et des choses comme une donnée intangible de l’univers. Et en même temps, ils nous disent, à vous, à moi, à n’importe qui, la possibilité de tout recommencer par lui-même. Comme si entre « il y avait une fois » et « il y aura une fois », chaque être pouvait soudainement entrevoir la perspective folle de son devenir singulier. Comme si, avant même de nous en rendre compte, la perspective de la poésie prenait forme dans le cœur de chacun de nous.
En fait, la poésie et l’amour se confondent avec la recherche de cet espace encore à venir, que c’est à chacun de nous d’inventer, en jouant tout à chaque fois entre le rien et l’infini. La force de la poésie est de nous permettre de jouer à nouveau ce grand jeu, en nous révélant qu’un mot, une phrase comme un regard, une rencontre, un geste… font que, malgré tout, ne serait-ce que pour un moment, le monde soit parfois à la hauteur de nos désirs, capable de répondre, contre toute attente, à cette « soif insatiable d’infini » dont parlait Lautréamont.
Et c’est précisément ce que chaque société essaie de nous faire oublier, si ce n’est de détourner, pour affirmer son ordre. En revanche, c’est l’un des principaux ressorts du capital, en particulier dans nos sociétés post-industrielles, où l’hyperconsommation devrait compenser toutes les pénuries. À tel point en remarquant en 2000 l’excès d’objets, d’images et d’informations qui reconditionnaient nos vies, il m’a semblé essentiel d’attirer l’attention sur cet « excès de réalité« . C’est précisément le titre de l’essai que Martina Guerrini a traduit en italien, dans lequel je montre quelle nouvelle forme de censure en découle.
Censure aussi inquiétante que rentable, puisqu’elle ne se manifestait plus par interdiction mais par excès, excès de marchandises, d’informations, d’images, qui encombrait de plus en plus le paysage jusqu’à faire disparaître toute perspective imaginaire.
Par conséquent, rien ne pouvait empêcher la situation de s’aggraver et de nous amener de cet « excès de réalité » à un excès de déchets, c’est-à-dire à un monde dont le fonctionnement conduit à sa propre ruine, qu’il s’agisse du changement climatique ou de la libéralisation économique, avec, à chaque fois, des catastrophes humaines d’abord inimaginables mais que nous avons découvertes plus tard, l’une après l’autre.
Petit à petit, j’ai été attaqué par l’inévitable laideur du monde qui a suivi. Cependant, je me suis rendu compte que cette laideur n’était pas seulement due à la surproduction de déchets, mais aussi au fait que la marchandisation de tout devenait la seule réponse à une situation catastrophique que le capital essayait de masquer tout en profitant.
En fait, à y regarder de plus près, cette laideur endémique doublait grâce à une esthétisation trompeuse. Je fais référence à une véritable cosmétisation du monde – qui s’affirme dans le faux luxe des marques ainsi que dans la gentrification des villes ou dans le secteur de la chirurgie esthétique et de la musculation – c’est-à-dire à travers un relookage général qui, en plus d’ouvrir de nouveaux marchés, présentait l’avantage de nous faire accepter, en la niant, une situation de plus en plus alarmante.
En réalité, entre fuite et fausse conscience, un système de rejet s’était mis en place qui, depuis les années quatre-vingt-dix, a été renforcé par une collusion soudaine entre la finance, l’art contemporain et les industries du luxe et qui, depuis lors, a continué à croître de manière effrayante.
Qu’on le veuille ou non, c’était une guerre dont, sans le savoir, nous étions l’enjeu. Une guerre implacable menée contre tout ce dont on ne peut tirer de la valeur, de sorte que c’est la totalité de notre vie sensible qui était assiégée, qu’il s’agisse de nos rêves, de nos passions ou de nos désirs, quels qu’ils soient. Une guerre totale contre ce qui n’a pas de prix, pour reprendre le titre de mon essai de 2018, dans lequel j’ai essayé de rendre compte de la violence de ce qui se passait.
À cet égard, le rôle décisif que les pouvoirs financiers ont attribué à l’art contemporain a été et est toujours remarquable. C’est à juste titre que le critique Wolfgang Ulrich a parlé d’un « art des gagnants pour les gagnants », car si d’un pays à l’autre nous avons pu voir les mêmes multinationales s’installer avec les mêmes produits, la même chose s’est produite en même temps avec les investissements culturels, multipliant les mêmes expositions des mêmes artistes dans le monde entier, afin de pousser chacun à devenir le spectateur hébété de la transmutation de l’art en argent et de l’argent en art. D’ailleurs, le gigantisme qui caractérise l’art contemporain correspond à cette violence de l’argent qui s’efforce de liquider notre nuit sensible.
D’autant plus que l’effet de sidération qui en découle a l’avantage de suspendre toute réflexion critique et, de cette manière, d’assumer la fonction de dressage attribuée à cet art contemporain, c’est-à-dire de nous habituer à accepter le fait accompli de ce totalitarisme de la marchandise que l’on prétend sans alternative. Et il y parvient de manière très concrète par une invasion de plus en plus agressive de l’espace public, jusqu’à l’anéantir pour le transformer en un espace commercial, où le gigantisme de la publicité rivalise ou même se fond avec celui des créations d’art contemporain parrainées par les investisseurs les plus riches.
On peut l’observer actuellement dans le centre de Paris, où Louis Vuitton, pour vendre sa dernière collection de sacs à 3 ou 4 000 euros, a érigé une statue de quinze mètres de sa “créatrice” Kusama , qui est par hasard une “star” de l’art contemporain.

Il est difficile de ne pas y voir une correspondance avec le « don » des Tulipes que Jeff Koons a fait payer à la ville de Paris à un prix exorbitant. Dans les deux cas, la même porosité entre l’art et l’argent affirme la même brutalité que cette smart-colonisation, à laquelle travaille activement l’art contemporain, dont la raison d’être équivaut de plus en plus à l’objectif de supprimer ce qui n’a pas de prix.
J’étais arrivé à cette conclusion il y a trois ans, lorsque j’ai eu l’occasion d’élargir cette analyse avec Juri Armanda. La réflexion de ce philosophe sur les arts visuels m’a amené à déterminer ce que cette marchandisation de tout doit à Internet et au nouveau statut attribué à l’image. Il a été suivi par l’essai Ceci tuera cela (2021), dans lequel nous avons analysé comment le monde numérique a pris l’image en otage, pour en faire l’agent privilégié du capital, à la fois comme source inépuisable de profit et comme outil de contrôle parfait.
Surtout depuis que l’introduction du smartphone, qui permet à quiconque de distribuer l’image au moment même où elle est produite, a fait de notre regard le principal objet de la convoitise du capital, comme l’étaient auparavant l’or et le pétrole. Ainsi, comme Walter Benjamin avait mis en évidence la révolution que constitue la reproduction mécanique de l’image, nous avons pu reconnaître un changement au moins aussi important avec le déferlement de milliards d’images qui nous a fait sortir de l’ère de la reproduction pour entrer dans celle de la distribution. La nouveauté était que la disparition de chaque intermédiaire était au service de l’un des rêves les plus fous de la rentabilité du capital. Avec la conséquence fatale que, comme l’image n’existait pas tant pour son contenu que pour le nombre de fois où elle serait regardée, le regard et l’image n’étaient désormais liés que par le nombre. De telle sorte que l’image ne montre plus mais se montre, pour générer la véritable dictature de la visibilité dans laquelle nous vivons maintenant.
Ainsi, en l’espace de dix ans, la distribution est devenue le cœur mathématique d’une nouvelle économie du regard, dont chacun est paradoxalement destinée à être à la fois le fournisseur et le client. Jamais auparavant le pouvoir de l’argent n’avait pénétré aussi profondément dans l’être, avec le risque de provoquer un équivalent psychique de l’évolution irréversible que l’Anthropocène représente pour la nature de notre planète.
Ce qui est surprenant, c’est que la plupart des critiques n’ont pas mesuré la reconfiguration sensible à laquelle nous avons été soumis depuis, selon des algorithmes qui établissent entre les êtres et les choses un système de relations qui sont immédiatement transformées à des fins lucratives. À tel point que ce n’est plus seulement l’immédiateté qui remplace toute autre relation avec le temps, comme certains l’ont remarqué mais sans se rendre compte que nous ne vivons plus dans le même espace.
Je citerai à titre d’exemple les innombrables forêts de regards parallèles que la pratique du selfie fait naître jour après jour dans le monde entier. Une pratique qui abolit toute perspective commune pure et simple, comme le montre, comparée au célèbre dessinateur de Dürer, cette photographie d’Hilary Clinton pendant sa campagne électorale.

Une image significative du bouleversement de notre rapport au monde : ses partisans lui tournent le dos pour la faire entrer dans l’espace, définitivement zoomé sur eux-mêmes, du petit monde de leur smartphone dont ils se croient maîtres, alors qu’ils en sont déjà définitivement prisonniers. Et, de plus, ils sont complètement inconscients qu’ils perdent toute notion de perspective et de point de fuite, sur laquelle repose depuis des siècles l’idée d’un espace commun.
Ce qu’a d’ailleurs confirmé l’épidémie de Covid avec son confinement. Quelques jours ont suffit pour que se révèle la force programmatique de la nouvelle culture dans laquelle nous étions entrés : l’image en était la clé et la visibilité notre condition d’existence.
C’est précisément ce qu’Eric Schmidt, ancien PDG de Google mais toujours propriétaire de plus de 5,3 milliards de dollars d’actions de la société mère de Google, a jugé utile de souligner sur la chaîne de télévision CBS le 10 mai 2020 : « Ces mois de quarantaine nous ont permis de faire un bond de dix ans. Internet est devenu vital du jour au lendemain. C’est essentiel pour faire des affaires, pour organiser notre vie et pour la vivre.

Tout a été dit et personne n’a trouvé de redire. Les États et les peuples se sont adaptés, comme nous le savons. En témoignent d’ailleurs les impressionnantes cartes de eye-tracking qui établissent en permanence l’immensité du phénomène, mettant en évidence les mouvements oculaires de milliards d’internautes. Il s’agit de véritables gisements de regards ouverts à l’exploitation intensive par Apple, Google, Facebook et Amazon, dont l’avidité insatiable des fournisseurs d’images ne se limite pas à la collecte de toutes les données possibles. Cette expropriation de notre regard se poursuit par une manipulation constante des images qui, obéissant au principe de similarité imposé par les algorithmes, est à l’origine de l’instauration de nouveau savoirs. La nouveauté réside dans le fait que, pour la première fois, le savoir, le contrôle et le profit sont inextricablement liés au modèle des techniques de personnalisation commerciale.
C’est-à-dire que le savoir devient une entreprise privée aux bénéfices incommensurables, tout comme Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, n’a jamais manqué de réitérer chaque année ce qu’il a déjà dit à l’introduction en bourse d’Amazon en 2007 : « Grâce à la personnalisation, le commerce en ligne accélérera le processus de découverte lui-même ».
Plus qu’une nouveauté, il s’agit d’une véritable révolution indissociable de l’ère de la distribution : pour la première fois, le capital et la technologie partagent absolument le même objectif de tout réduire au chiffres. Ce que l’on pourrait définir comme un cynisme technologique, issu de la rationalité du profit, se manifeste en doublant le cynisme du capital dans une escalade que rien ne semble pouvoir arrêter. Et cela passe par une dématérialisation de l’image qui entraîne une dématérialisation par l’image qui induit le renversement de tout en son contraire, la liberté en esclavage, la collectivité en solitude, la singularité en similitude…
En fait, presque personne n’a réalisé que le monde numérique n’a pas l’intention de combattre ce qu’il remplace. Au contraire, il se présente même comme une optimisation, qui lui permet d’installer ses dispositifs de contrôle et de profit, sans en mesurer les conséquences réelles. C’est le piège. Quelque chose disparaît, sans que l’on sache quoi ou comment.
C’est pourquoi il est urgent de prendre la mesure de ce que la distribution exponentielle des images nous fait perdre, en nous enfermant chaque jour un peu plus dans le vertige de son décervelage. La seule question est maintenant de savoir s’il existe un moyen de sortir de ce labyrinthe, dans lequel il est de plus en plus difficile de faire la distinction entre la réalité et la fiction. Je n’ai pas pu sortir de cette question lorsque la maison d’édition Flammarion m’a proposé de réfléchir à un choix d’images. Au début, j’étais réticent. Tout d’abord, il y avait un risque d’esthétisme qui me dérangeait dans un tel projet. Quelque chose comme une façon élégante d’échapper à cet « excès de réalité » que j’avais dénoncé depuis les années 2000.
Ainsi, considérer une sorte de musée imaginaire représentait la négation de cette colonisation intensive à travers l’image qui reconfigurait la sensibilité de chacun. Mais, d’un autre côté, j’avais tellement aimé les images, elles signifiaient tellement pour moi que je ne pouvais pas me résoudre à les laisser me trahir comme ça. À tel point que je n’arrêtais pas de me demander s’il y en avait quelques unes qui pouvaient échapper à l’asservissement qui les menaçait toutes. Du coup, la proposition qui m’avait été faite m’a donné l’occasion d’approfondir cette question.
C’est alors que me revinrent avec insistance certaines images qui, au fil du temps, m’avaient marqué par leur pouvoir d’énigme. Evidemment, c’est cette énigme qui leur a permis d’échapper au recrutement de tous les autres. Au point de leur donner l’allure d’ images fugaces , comme si elles étaient émues par l’urgence de ne pas se laisser exproprier de leur secret, c’est-à-dire de la part d’ombre qu’elles portaient.
De toute évidence, c’est cette ombre qui les transportait et les sauvait du naufrage de toutes les autres dans les turbulences de la visibilité. D’out l’idée d’une vitesse de l’ombre qui les maintenait au-dessus de la mêlée, celle qui leur permettait de déserter, et il est clair que cette vitesse de l’ombre avait à voir avec le peu de liberté qu’il nous restait peut-être.
D’où l’étrange voyage que j’ai entrepris à la suite de 13 images, dont le seul point commun était de n’avoir aucune valeur affective pour moi. C’est alors que j’ai décidé de tenir un journal de bord pour en savoir plus sur cette vitesse d’ombre. Puisque, si ces images étaient les plus disparates, qu’il s’agisse de tableaux célèbres comme la chasse nocturne aux oiseaux, de gravures anonymes ou de photographies, notes ou inconnues…, je les ai vues se regrouper pour donner naissance à 5 constellations qui m’ont soudainement semblé faire sens, sans que je sache bien lequel. Ainsi, la première, qui s’esquissait à partir d’un dessin de Marcel Duchamp de 1914 et d’une gouache de Magritte de 1942, jouant tous deux sur la même absence d’horizon, m’a semblé ouvrir un chemin entre l’invisible et l’indicible jusqu’à induire une autre
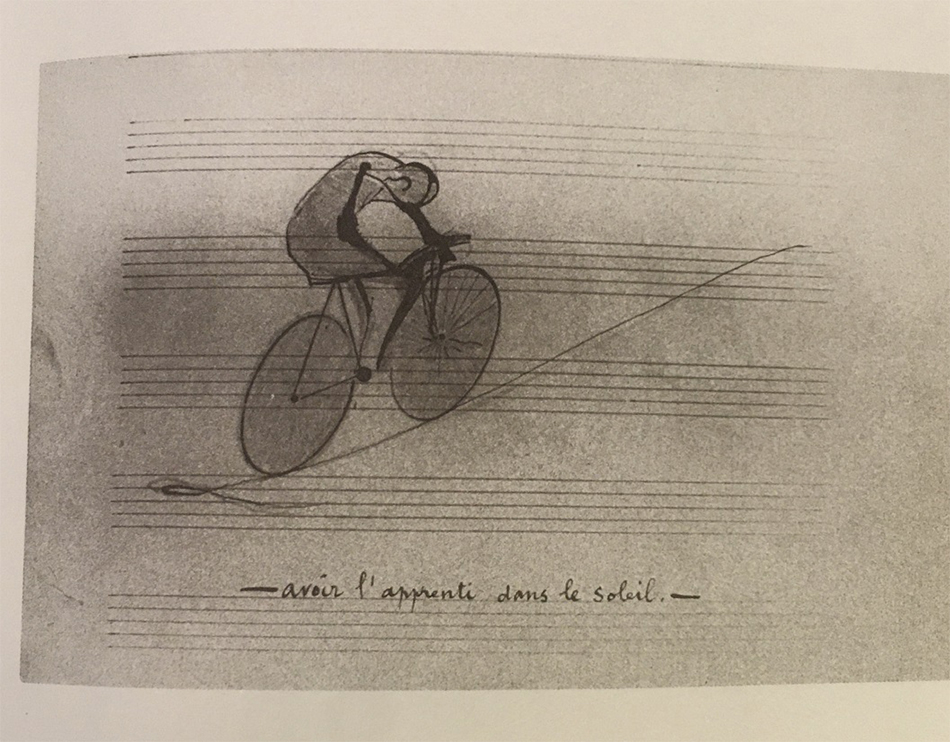
En réalité, cette question sur les images et à travers les images était en train de devenir une image, dans la mesure où chacune d’elles participait à la conception d’improbables constellations en devenir. Mais en même temps me faisant découvrir l’importance de cette nuit dans laquelle se jouaient ces images. Et cela au point de révéler, au sens photographique du terme, combien, par contraste, nous étions désormais continuellement privés de l’espace dans lequel nous projeter, qu’il s’agisse de nos gestes ou de nos rêves. En réalité, ce que ces constellations montraient, c’était notre immensité perdue. Et de la même manière, qu’une nouvelle et redoutable censure s’exerçait non pas tant sur le contenu des images, mais sur l’espace d’où elles pouvaient surgir et qu’elles faisaient soudain vivre .
C’est ainsi que j’ai commencé à percevoir l’importance paradoxalement politique de ces images éphémères.
Parce que rien n’allait plus à l’encontre de la compression d’images systématiquement pratiquée dans le monde numérique, afin de réduire le visible à une masse de signes codés immédiatement exploitables par les algorithmes. Au contraire, sans vraiment m’en rendre compte, d’une constellation à l’autre, j’ai découvert quelque chose comme la cartographie d’un ciel intérieur, ou plutôt d’un espace accessible à tous, mais où la singularité d’un désir encore non formulé semblait rejoindre les mouvements les plus lointains du monde.

C’est alors que je me suis souvenu de la façon dont les deux grands penseurs de l’image du XXe siècle, Aby Warburg et Walter Benjamin, étaient attentifs à ce qui se passe autour de l’image. Benjamin avec le champ magnétique de l’aura, dont l’intensité ramène toute la distance autour de l’image originale, et Warburg avec son Atlas Mnemosyne, dont le fond noir des panneaux suggère la nuit universelle où les images ne cessent d’apparaître et de disparaître. C’est comme si les deux, sans vraiment en être conscients, avaient continuellement fait référence à l’espace imaginaire qui nous relie à tout ce que nous ne sommes pas, mais où les grands changements de sensibilité sont agités.
En réalité, c’est toujours sur cette autre scène que chaque époque a inventé, le plus souvent contre l’esprit du temps, sa liberté de façonner ce qui l’obsède. Cependant, il faut constater que l’Internet, un métavers comme tout ce qui est produit par l’intelligence artificielle, se substitue à cet espace. À tel point que, ce faisant, le capital est capable de réaliser son rêve, jusqu’ici inconcevable, d’un imaginaire dans lequel tout peut être acheté. Et c’est le trésor de gratuité avec lequel notre imaginaire s’est jusqu’ici confondu qui nous est systématiquement volé. Un événement inédit, contre lequel il ne semblait pas y avoir grand-chose à opposer, si ce n’est la désertion de ces images fuyantes qui nous ramenaient vers l’infini qui nous hante.
J’étais à ce moment-là l’été dernier, malgré tout impuissante, quand une amie m’a raconté qu’elle avait entendu un enfant marcher au soleil dire à sa mère : « mon ombre me rend plus grande ». C’était ceci : à l’instar de la « réappropriation individuelle » promue par les anarchistes à la fin du XIXe siècle pour reprendre ce dont la société leur avait volé, il ne tenait qu’à nous, de récupérer ce que ce monde nous volait, de recourir à cette vitesse de l’ombre qui ne cesse d’approfondir l’horizon en nous faisant devenir plus grands.
Et c’est sans doute pour cela que j’ai écrit ce livre qui ne ressemble à rien, car la vitesse de l’ombre m’aura entraîné sur tous les terrains lyriques, esthétiques et philosophiques…, ne serait-ce que pour tromper le réseau numérique.
Je ne sais toujours pas si c’est un moyen de sortir du labyrinthe, mais je suis sûr que dans la partie la plus cachée de sa nuit, tout le monde pourrait trouver une image tombante qui pourrait changer le paysage. Je ne connais donc pas la meilleure raison d’essayer d’attaquer le monde dupliqué qu’ils veulent nous faire passer pour la vie.